D’emblée, précisons que depuis ses origines jusqu’à la Révolution, Aubin s’appelait Albin (ou Albinio). Ce nom lui proviendrait du général romain Decimus Clodius Albinus, lequel général revendiqua le pouvoir impérial à Rome en 193 après J.-C. mais en fut évincé par Septime Sévère qui lui infligea une cuisante défaite à la bataille de Lugdunum (février 197), défaite qui conduisit Albinus à se donner la mort. Or, on raconte que c’est Albinus qui, lors de son passage en Gaule, fonda un castrum (une place fortifiée) à Aubin.
Mais si l’on se penche sur l’étymologie d’Aubin (anciennement Albin), on s’aperçoit que ce nom peut également dériver du latin albus qui signifie “blanc”, “Albus” ayant aussi été un nom porté par nombre d’esclaves et d’affranchis. De sorte que c’est peut-être un ancien esclave affranchi qui, installé à Aubin durant la période gallo-romaine, donna son nom au lieu qui nous intéresse aujourd’hui.
Les premiers seigneurs d’Aubin
Ce qui n’empêche pas que l’endroit a certainement dû être très tôt fortifié, le piton rocheux qui domine la vallée de l’Enne se prêtant particulièrement bien à l’édification d’une citadelle. Mais ce n’est qu’à partir du Xe siècle que l’on trouve mention d’une forteresse à Aubin, plus précisément dans le testament que Raymond Ier, comte de Rouergue, fit en l’an 961, juste avant son départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle, voyage périlleux au cours duquel il devait, du reste, trouver la mort.
Aux termes de ses dispositions testamentaires, Raymond Ier légua notamment le château d’Albin (le “Castello de Albinio”) aux deux fils naturels qu’il avait eu de la fille d’un certain Odouin (ou Odoin). Ces derniers, respectivement prénommés Reginon et Hector, acquirent très vite une mauvaise réputation, au point que le château d’Aubin ne fut bientôt plus connu que sous le nom de “Rocher de Brigands”. Suite à leurs forfaits, les deux frères furent excommuniés, ce qui attisa leur haine envers les religieux, et en particulier les moines de Conques, qui possédaient des biens à l’intérieur même de la châtellenie d’Albin.
Or, un jour que le moine conquois ayant pour nom Bergaud était occupé à moissonner un champ, Reginon d’Albin, conduisant alors une petite troupe de cavaliers, se rua sur le moine dès qu’il le vit avec l’intention de le faire écraser par son cheval. Mais, arrivé à seulement quelques mètres de sa victime, son destrier se cabra brusquement, propulsant Reginon de façon si violente que celui-ci heurta le sol la tête première et fut tué sur le coup. Nous ne savons si cette histoire est exacte ou si elle tient davantage de la légende.
Toujours est-il que les moines conquois ont souhaité immortaliser cet événement, vu comme une punition divine, en le sculptant sur le tympan de l’église abbatiale Sainte-Foy de Conques. De fait, on peut y voir un chevalier en cotte de mailles chuter lourdement sur la tête après avoir été désarçonné. À noter qu’au moment même où il touche le sol, deux démons viennent s’emparer de lui pour l’emmener en enfer. Cependant, quelques années plus tard, vers l’an mille, les seigneurs d’Albin s’attirèrent de nouveau les bonnes grâces des moines conquois après leur avoir fait quelques donations d’importance.
Albin au fil des siècles
Dans les siècles qui suivirent, des alliances et autres ventes furent à l’origine du morcellement de la seigneurie d’Albin. Ainsi, les propriétaires indivis se multiplièrent au point de dépasser rapidement la trentaine de coseigneurs. Cette situation toute particulière engendra naturellement de fréquentes querelles entre les différents possesseurs de droits (dont faisait partie le comte de Rodez) aboutissant à de nombreux procès.
Toutefois, en 1275, une convention fut passée entre les coseigneurs devant Simon Iovenca, notaire à Albin, laquelle convention fut source d’un certain apaisement. De fait, aux termes de cette transaction, il fut décidé qu’à Albin, la justice (mais seulement en ce qui concerne le civil) serait désormais rendue par un juge unique choisi par le comte de Rodez, la Haute Justice continuant à relever de la compétence dudit comte, seul habilité à juger des délits capitaux (vol, viol, meurtre, etc.).
Nous poursuivons l’histoire d’Aubin pour découvrir qu’en 1349, la population d’Albin s’élevait à 205 feux, ce qui représente environ 1.025 habitants, nombre non négligeable. À partir de 1394, on commença à renforcer les fortifications de la citadelle comme on restaura également les faces nord, sud et ouest de la tour-clocher de la petite église de la Cène (située à l’intérieur même de l’enceinte fortifiée), lequel clocher servait aussi de tour de guet.
Bien plus tard, en 1465, la ville d’Albin fut prise et sa forteresse momentanément occupée par la troupe d’un certain Salazart. S’agissait-il de Jean Salazar, le célèbre mercenaire, capitaine d’une compagnie de cent lances, qui fut particulièrement actif pendant la guerre de Cent Ans ? Toujours est-il que lorsque Albin tomba entre les mains de ces routiers, la ville fut livrée au pillage et aux flammes.
Un peu plus de deux décennies plus tard, plus exactement en 1489, un arrêt du Parlement fut rendu contre le comte de Rodez Charles d’Armagnac qui perdit plusieurs places fortes au nombre desquelles se trouvaient Rodez, Rignac et, bien entendu, Albin (ces places fortes ayant alors été réunies à la couronne de France).
Parvenus à l’époque des guerres de Religion, nous apprenons que la cité d’Albin tomba, en 1590, entre les mains des huguenots. Toutefois, ces derniers en furent rapidement chassés par le sieur Richard de Poux (ou de Poutz) qui, à ce moment-là, n’était autre que le commandant du château. La paix étant enfin revenue dans notre région, on ne jugea pas utile de conserver une garnison à Albin et les soldats quittèrent la place au milieu du XVIIe siècle.
Ainsi abandonné, le fort commença à se dégrader et fut même démantelé au XVIIIe siècle. Comme nous l’explique Lucien Mazars dans son ouvrage sur Aubin, une délibération communale en date du 17 mars 1776 autorisa Jean Antoine Brassat père, sieur du Sicol, à prendre de la démolition du fort 200 charrettes de pierres. Enfin, sous la Révolution, la haute tour carrée du fort d’Aubin, véritable donjon, menaçant ruine, fut vendue comme bien national le 30 août 1796. Elle fut adjugée, avec un autre bien immobilier, à Guillaume Bergougnan, de Rodez, soumissionnaire pour Jean Antoine Brassat, moyennant le prix principal de 252 livres.
Le fort d’Aubin
À l’origine, le fort d’Aubin était ce que l’on appelait un “cap barré”, soit un éperon rocheux dont les défenses naturelles étaient améliorées en taillant le rocher et en y ajoutant des fortifications. Précisons ici que la plupart des caps barrés remontent à l’âge du fer. Nous ne savons si le cap barré d’Aubin date de cette époque.
En tout cas, les vestiges que l’on peut y voir, que ce soient les restes de la tour carrée (le donjon) qui, avec ses murs d’1,20 m d’épaisseur, devait être aussi haute que le clocher de l’église de la Cène (12 m de haut), ou encore l’ancien logis seigneurial dont il n’existe plus que les points d’ancrage dans le rocher, sans oublier l’édifice religieux, se situent, pour leur part, entre le Xe siècle et le XIVe siècle.
Mais revenons un instant sur ce “cap barré” qui, il y a bien longtemps, fut isolé au nord par un fossé de 12 m de large et 8 m de profondeur. Ce cap barré, large d’une trentaine de mètres et long de 138 m, a vu son flanc ouest consolidé par la construction d’un mur de pierre présentant une hauteur de 10 à 12 m de haut. Nous nous devons également de signaler la présence passée d’une grande porte qui, autrefois flanquée de deux poternes, permettait la communication entre le château et le village d’Aubin (il n’en reste absolument plus rien aujourd’hui). Il devait aussi exister d’autres tours qui subirent le même sort que celui de la porte. Enfin, notons qu’en 1858, un chemin de croix fut installé à l’emplacement même du fort.
Pascal Cazottes








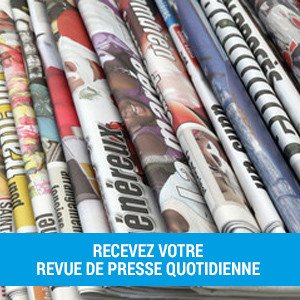

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.