D’après Bosc, ancien professeur au collège de Rodez et auteur de l’ouvrage “Mémoires pour servir à l’Histoire du Rouergue”, publié pour la première fois en 1797, le village de Lacalm est un des plus anciens du pays. Se penchant aussi sur son étymologie, il nous apprend que le nom de “Lacalm” dérive d’un vieux mot celtique signifiant “haute plaine”. Mais en consultant l’incontournable ouvrage de Jacques Astor intitulé “Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de la France”, nous découvrons que Lacalm s’orthographiait “La Calmp” en 1281 et qu’il y a de fortes chances pour que ce nom provienne de l’occitan “calm” servant à désigner un plateau rocheux. En tout cas, qu’il soit situé dans une haute plaine ou sur un plateau rocheux, ces termes s’appliquent parfaitement au village de Lacalm qui, positionné à 1.130 mètres d’altitude, est l’un des villages les plus élevés du département de l’Aveyron.
En ce qui concerne l’histoire de Lacalm, celle-ci remonterait au VIIIe siècle. En effet, toujours d’après Bosc, le roi Pépin le Bref, se trouvant alors à Narbonne (en 767), aurait signé un acte (Bosc parle d’un diplôme) par lequel il établissait à Lacalm un conseil municipal composé de six conseillers présidés par un consul et auquel conseil il donna la police civile et celle du fort, «avec le droit de porter robes et chaperons et de juger les différends qui pourraient s’élever entre les habitants et les étrangers, au sujet des marchés et pactes de commerce qui auraient lieu dans les foires de cette petite ville».
Mais tout en remarquant que Lacalm eut ainsi des consuls plusieurs siècles avant aucune autre ville du pays, Bosc émet des réserves quant à l’authenticité de cet acte. Pour le Baron de Gaujal, qui rappelle lui aussi cette histoire dans le tome II de ses “Études historiques sur le Rouergue”, il n’y a aucun doute possible : il ne peut s’agir là que d’une légende. Pour reprendre les mots du Baron de Gaujal : «ce diplôme n’est rien moins qu’authentique».
Il en va tout autrement du passage du roi Louis VIII à Lacalm au mois d’octobre 1226, soit durant la croisade royale contre les Albigeois et un mois seulement avant la mort de ce souverain. En effet, non seulement la venue du monarque à Lacalm est-elle attestée mais encore ce dernier en profita-t-il pour confirmer aux habitants de Lacalm tous leurs privilèges. Ne s’arrêtant pas à ces seules largesses, Louis VIII accorda également aux Lacannais, en récompense pour leurs courses et expéditions militaires, la jouissance de divers bois, dont ceux de Guirande et de La Cazelle, et ce, de manière à ce qu’ils aient du bois de construction pour l’édification de leurs édifices.
Nous faisons un petit bond dans l’Histoire pour parvenir à la guerre de Cent Ans. À cette époque, plus précisément en 1353, les Anglais réussirent à s’emparer du fort de Lacalm qui se situait sans doute à un emplacement proche de l’église du lieu. À plusieurs reprises, la soldatesque anglaise avait été repoussée par les gens du pays, qui s’étaient retranchés derrière des palissades réalisées avec du bois de sapin. Aussi, lorsque le fort tomba finalement aux mains de l’ennemi, celui-ci, pour se venger de l’héroïque résistance des Lacannais, le détruisit entièrement par le feu.
Trente années plus tard, soit en 1383, les villageois décidèrent d’édifier une tour qui leur servirait de refuge, tout en promettant au comte d’Armagnac et de Rodez de lui en réserver une partie.
Précisons ici que les comtes de Rodez eurent pendant longtemps en leur possession, à Lacalm, le fort dont il a été ci-dessus fait mention, ainsi qu’un château qui se trouvait vraisemblablement à l’ancien foirail et qui portait le nom de “l’Allée” (à noter que ce château existait encore en 1476). Mais, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les comtes de Rodez se séparèrent de la seigneurie de Lacalm, la cédant à Guillemot de Solages, baron de Tholet. Ces droits seigneuriaux passèrent ensuite aux de Cocural qui, eux-mêmes, les transmirent à la famille de la Vayssière.
L’église Sainte-Foy
Après ce bref rappel historique, allons maintenant à la découverte de l’église de Lacalm qui présente cette spécificité d’être à la fois romane et gothique.
De sa période romane, l’église Sainte-Foy de Lacalm a conservé une nef avec voûte en berceau, une abside à plein cintre et, bien entendu, des chapiteaux historiés dont les sculptures ne sont pas sans évoquer celles que l’on peut voir dans l’abbatiale de Conques. Ainsi figurent, notamment sur ces chapiteaux, des anges tenant un livre ou un phylactère dont l’inspiration ne peut provenir que de l’atelier de Conques.
Mais l’église ayant été remaniée au XVe siècle (vers 1460), elle comporte aussi une partie gothique, particulièrement visible dans le bas-côté droit où les clefs de voûte et les culs-de-lampe datent bien évidemment de cette époque. Du reste, deux culs-de-lampe représentent des têtes d’hommes coiffées avec un chaperon tel que la gent masculine le portait au XVe siècle.
Naturellement, à l’intérieur de l’église, nous ne manquons pas d’admirer une très belle statue de sainte Foy représentée avec un gril, l’instrument de son supplice. Nous remarquerons que la présence d’une figuration de cette sainte qui a, du reste, donné son nom à l’église de Lacalm, nous ramène une nouvelle fois à Conques où l’abbatiale est dédiée à la sainte agenaise.
La vierge à la croix ancrée
Mais l’objet qui retient le plus notre attention est, sans conteste, une statuette en pierre (sans doute du XVe siècle) représentant une Vierge à l’enfant. Cette petite statue, placée dans une niche du collatéral droit, a ceci de particulier qu’un ange a été sculpté au pied de la Madone. Or, l’ange en question tient entre ses mains un écu sur lequel figure une croix ancrée. Précisons ici que la croix ancrée possède des branches dont les extrémités se terminent par des doubles pointes recourbées et pointues (faisant bien entendu penser aux ancres des bateaux). Et puisque nous parlions à l’instant “d’ancre”, nous noterons que cet objet, servant à stabiliser un navire à un endroit voulu, a parfois été représenté sur les tombes des premiers chrétiens, car l’ancre, symbole de la fermeté (les vagues ne pouvant l’ébranler), de la constance ou encore de l’espérance, rappelait la solidité de la foi chrétienne, comme elle était également l’emblème du salut. La croix ancrée reprend ce symbolisme, puisqu’elle évoque la stabilité de la foi en dépit des épreuves. Enfin, nous remarquerons que les marins emportaient souvent avec eux des croix ancrées lors de leurs voyages maritimes, pensant ainsi se protéger des dangers de la mer.
Pascal Cazottes








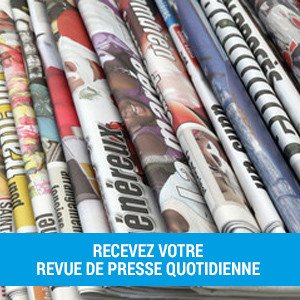

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.